PROBLEMES
- absence de respiration ou pr�sence de hoquets espac�s ;
- respiration difficile (moins de 30 mvts/min ou plus de 60,
tirage intercostal ou geignement expiratoire) ;
- cyanose
(coloration bleut�e) ;
- enfant pr�matur� ou de poids tr�s faible � la naissance
(�ge gestationnel inf�rieur � 32 semaines ou poids inf�rieur �
1500 g) ;
- absence de r�activit� ;
- hypothermie (temp�rature axillaire inf�rieure � 36,5
�C) ;
- convulsions.
- un poids faible � la naissance (entre 1500 et 2500 g) ;
- un risque d’infection bact�rienne chez un nouveau-n�
apparemment normal lorsqu’il y a eu rupture pr�matur�e ou
prolong�e des membranes ;
- un risque de syphilis cong�nitale chez le nouveau-n� lorsque
le test s�rologique de la m�re est positif ou lorsque celle-ci
pr�sente des sympt�mes de syphilis.
PRISE EN CHARGE IMMEDIATE
Trois situations demandent une prise en charge imm�diate : l’absence
de respiration (ou la pr�sence de hoquets espac�s,
la cyanose (coloration bleut�e) ou une respiration difficile.
ABSENCE DE RESPIRATION OU HOQUETS ESPAC�S
PRISE EN CHARGE GENERALE
REANIMATION
Encadr� S-8
Mat�riel de r�animation
Afin d’�viter
de perdre du temps dans les situations d’urgence, il est vital de s’assurer
que le mat�riel est en bon �tat avant d’avoir � s’en servir :
-
v�rifier qu’on dispose de masques � la bonne taille en se
fondant sur la taille que devrait faire l’enfant (taille 1 pour un
nouveau-n� de poids normal et taille 0 pour un enfant de petite
taille) ;
-
ajuster le masque en assurant son �tanch�it� avec la
paume de la main et presser le ballon :
- si l’on sent une pression
contre sa main, c’est que le ballon produit la pression n�cessaire
;
- si le ballon se regonfle lorsqu’on desserre la prise, c’est qu’il
fonctionne correctement.
|
DEGAGEMENT DES VOIES AERIENNES
- l’allonger sur le dos ;
- positionner la t�te
l�g�rement en extension pour d�gager les voies a�riennes ;
-
veiller � ce qu’il reste bien envelopp� ou couvert, � l’exception
du visage et du haut du torse.
Figure S-28
Bonne
position de la t�te pour la ventilation - noter que le cou est moins
en extension que chez l'adulte
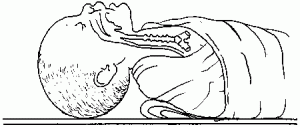
-
D�gager les voies a�riennes en aspirant les mucosit�s, d’abord
dans la bouche, puis dans les fosses nasales. Si la bouche ou le
nez de l’enfant contiennent du sang ou du m�conium, les aspirer
imm�diatement afin d’emp�cher l’enfant de les inhaler.
Note
: Ne pas aspirer les mucosit�s au fond de la gorge car cela
risquerait d’entra�ner un ralentissement cardiaque ou un arr�t
respiratoire chez l’enfant.
- s’il
crie ou commence � respirer, il n’y a pas lieu de faire quoi
que ce soit d’autre dans l’imm�diat et il convient
ensuite de lui prodiguer les premiers soins n�onatals
;
- s’il ne respire toujours pas, commencer la ventilation (voir
ci- dessous).
VENTILATION DU NOUVEAU-NE
-
V�rifier � nouveau la
position de l’enfant. Le cou doit �tre en l�g�re extension
(figure S-28, voir ci-dessus).
-
Positionner le masque et en v�rifier l’�tanch�it� (figure
S-29, ci-dessous) :
- appliquer le masque sur le visage de l’enfant,
de fa�on � ce qu’il recouvre le menton, la bouche et le nez ;
- cr�er une �tanch�it� entre le masque et le visage de l’enfant
;
- presser le ballon avec deux doigts seulement ou avec la main
tout enti�re, en fonction de la taille du ballon ;
- v�rifier l’�tanch�it� du masque en ventilant � deux
reprises et en regardant si la poitrine se soul�ve.
Figure S-29
Ventilation au ballon et au masque

- Si la poitrine de l’enfant se soul�ve, la
pression de ventilation est probablement suffisante.
- Si la poitrine de l’enfant ne se soul�ve pas
:
- aspirer � nouveau la bouche et le nez de l’enfant
pour retirer le mucus, le sang ou le m�conium qui obstruent les
voies a�riennes.
- v�rifier � nouveau la position de l’enfant (figure
S-28) et, le cas �ch�ant, la corriger ;
- r�ajuster le masque afin d’en am�liorer l’�tanch�it�
;
- presser le ballon avec plus de force afin d’augmenter
la pression de ventilation ;
-
Si on a donn� de la p�thidine ou de la morphine
� la m�re avant l’accouchement, envisager d’administrer de
la naloxone au nouveau-n� une fois que les signes vitaux
seront pr�sents (encadr� S-9).
-
Ventiler l’enfant pendant 1 minute puis arr�ter
et v�rifier rapidement s’il respire spontan�ment :
- s’il respire normalement (30 � 60
mvts/min), ne pr�sente pas de tirage intercostal et n’�met pas
de geignement expiratoire pendant 1 minute, il n’est plus
n�cessaire de le r�animer et il convient ensuite de lui prodiguer
les premiers soins n�onatals ;
- s’il ne respire pas ou s’il a une
respiration faible, poursuivre la ventilation jusqu’� ce qu’une
respiration spontan�e s’�tablisse.
- s’il respire normalement (30 � 60 mvts/min), ne
pr�sente pas de tirage intercostal et n’�met pas de
geignement expiratoire pendant 1 minute, il n’est plus
n�cessaire de le ranimer et il convient ensuite de lui prodiguer les
premiers soins n�onatals ;
- si sa fr�quence respiratoire est inf�rieure �
30 mvts/min, poursuivre la ventilation ;
- s’il pr�sente un
tirage intercostal s�v�re, le ventiler, dans la mesure du possible,
avec de l’oxyg�ne (encadr� S-10) et prendre les
dispositions n�cessaires pour qu’il soit transf�r� dans le
service appropri� pour les nouveau- n�s malades.
- le transf�rer dans le service appropri� pour les
nouveau-n�s malades ;
- pendant le transfert, le maintenir au chaud et
continuer � le ventiler, si n�cessaire.
Encadr� S- 9
Rem�dier � la d�pression
respiratoire n�onatale provoqu�e par les narcotiques
Si on a administr� de la p�thidine ou de la
morphine � la m�re, le rem�de contre la d�pression
respiratoire du nouveau-n� qui peut en r�sulter est la
naloxone. Note : Ne pas administrer de naloxone au nouveau-n� s’il
se peut que sa m�re ait r�cemment consomm� des stup�fiants.
- Une
fois que les signes vitaux sont �tablis, lui injecter 0,1 mg de
naloxone par kg, en IV.
- Apr�s la r�animation, il est
possible d’injecter de la naloxone en IM � l’enfant s’il a
une circulation p�riph�rique suffisante. Il peut �tre
n�cessaire de renouveler l’injection pour pr�venir une
rechute.
-
Si l’enfant ne pr�sente pas de signe de
d�pression respiratoire, mais qu’on a administr� de la
p�thidine ou de la morphine � sa m�re, au cours des 4 h qui
ont pr�c�d� l’accouchement, l’observer et s’attendre �
voir appara�tre des signes de d�pression respiratoire, et, si
de tels signes apparaissent, proc�der comme indiqu� ci-dessus.
|
SOINS POST-REANIMATION
- mettre l’enfant sur la poitrine de sa
m�re, peau contre peau et lui couvrir le corps et la t�te;
- une
autre solution consiste � l’installer sous une lampe chauffante.
- si l’enfant est cyanos� (bleu�tre) ou s’il a du mal �
respirer (moins de 30 mvts/min ou plus de 60, tirage intercostal ou
geignement expiratoire), lui administrer de l’oxyg�ne � l’aide d’une
canule ou d’une sonde nasale (voir plus bas).
- si sa temp�rature est sup�rieure ou �gale
� 36 �C, le laisser sur la poitrine de sa m�re, peau contre peau et
encourager la m�re � l’allaiter ;
- si sa temp�rature est
inf�rieure � 36 �C, le r�chauffer..
- S’il
t�te bien, c’est qu’il r�cup�re bien.
- S’il ne t�te pas bien,
le transf�rer dans le service appropri� pour les nouveau-n�s malades.
CYANOSE OU DIFFICULTES RESPIRATOIRES
-
Si l’enfant est
cyanos� (bleu�tre) ou s’il a du mal � respirer (moins de 30
mvts/min ou plus de 60, tirage intercostal ou geignement expiratoire),
lui administrer de l’oxyg�ne � l’aide d’une canule ou d’une
sonde nasale :
- aspirer les mucosit�s de la bouche et du nez pour
d�sobstruer les voies a�riennes ;
- administrer 0,5 l d’oxyg�ne par
minute � l’aide d’une canule ou d’une sonde nasale (encadr�
S-10, ci-dessous) ;
- transf�rer l’enfant dans le service appropri�
pour les nouveau-n�s malades.
Encadr� S-10
Utilisation de l’oxyg�ne
Pour l’utilisation d’oxyg�ne, garder en
m�moire ce qui suit :
-
il convient de n’administrer de l’oxyg�ne
qu’en cas de difficult� respiratoire ou de cyanose ;
-
si l’enfant
pr�sente un tirage intercostal s�v�re, s’il �met des
hoquets espac�s pour respirer ou si la cyanose
persiste,
augmenter la concentration d’oxyg�ne administr� � l’aide
d’une canule, d’une sonde nasale ou d’une enceinte
c�phalique.
Note : L’utilisation inconsid�r�e d’oxyg�ne
chez les pr�matur�s est associ�e � un risque de
c�cit�. |
EVALUATION
Un grand nombre d’affections n�onatales
graves - infections bact�riennes, malformations, asphyxie grave et
maladie des membranes hyalines dues � la pr�maturit� - ont des
sympt�mes similaires � ceux des difficult�s respiratoires, de l’absence
de tonus et de la d�nutrition.
Il est difficile de distinguer ces
affections si l’on ne dispose pas de m�thodes diagnostiques.
Cependant, il est n�cessaire de commencer le traitement imm�diatement,
m�me en l’absence de diagnostic pr�cis. En cons�quence, lorsqu’un
enfant pr�sente une des affections susmentionn�es, il convient de
redouter une pathologie grave et de le transf�rer sans attendre dans le
service appropri� pour les nouveau-n�s malades.
PRISE EN CHARGE
ENFANT
DE POIDS TRES FAIBLE A LA NAISSANCE OU TRES PREMATURE
Si l’enfant est
tr�s petit (poids inf�rieur � 1 500 g ou �ge gestationnel inf�rieur
� 32 semaines), il est expos� � de graves probl�mes de sant� parmi
lesquels les difficult�s respiratoires, l’incapacit� � t�ter, l’ict�re
grave et les infections graves. Sans protection thermique sp�ciale
(incubateur, par exemple), l’enfant est expos� � un risque d’hypothermie.
Le nouveau-n� de tr�s petite taille a besoin de soins particuliers. Il
convient de le transf�rer le plus t�t possible dans le service
appropri� pour les b�b�s malades ou de petite taille. Avant et
pendant le transfert :
-
veiller � emp�cher le b�b� de se refroidir
; l’envelopper dans un linge doux et sec, puis dans une couverture et
veiller � ce que sa t�te soit couverte pour �viter la d�perdition de
chaleur.
-
Si compte tenu des ant�c�dents de la m�re, il est
possible que l’enfant ait une infection bact�rienne, lui administrer
une premi�re dose d’antibiotiques :
- 4 mg de gentamicine (ou de
kanamycine) par kg, en IM ;
- PLUS 100 mg d’ampicilline (ou de
benzylp�nicilline) par kg, en IM.
ABSENCE DE TONUS
En cas d’absence de tonus (tonus musculaire faible,
absence de mouvements), l’enfant a tr�s probablement une maladie
grave et il convient de le transf�rer dans le service appropri� pour
les nouveau-n�s malades.
HYPOTHERMIE
L’hypothermie peut survenir
rapidement chez un nouveau-n� de tr�s petite taille ou chez un
nouveau-n� qui a �t� r�anim� ou s�par� de sa m�re. Dans tous les
cas, sa temp�rature est susceptible de descendre rapidement en-dessous
de 35 �C. Il convient de le r�chauffer au plus vite.
- utiliser les moyens � disposition pour commencer �
le r�chauffer (incubateur, lampe chauffante, pi�ce chauff�e, lit
chauff�) ;
- le transf�rer au plus vite dans le service
appropri� pour les nouveau-n�s pr�matur�s ou malades ;
- s’il est cyanos� (bleu�tre) ou s’il
a du mal � respirer (moins de 30 mvts/min ou plus de 60, tirage
intercostal ou geignement expiratoire), lui administrer de l’oxyg�ne
� l’aide d’une canule ou d’une sonde nasale.
- veiller � l’emp�cher de se refroidir, l’envelopper
dans un linge doux et sec, puis dans une couverture et veiller � ce
que sa t�te soit couverte pour �viter la d�perdition de chaleur
;
- inciter la m�re � commencer l’allaitement d�s
qu’il est pr�t ;
- surveiller sa temp�rature axillaire toutes les
heures jusqu’� ce qu’elle soit normale ;
- une autre solution consiste � le mettre dans un
incubateur ou sous une lampe chauffante.
CONVULSIONS
Il est rare que des convulsions surviennent au cours de
la premi�re heure suivant la naissance. Elles peuvent r�sulter d’une
m�ningite, d’une enc�phalopathie ou d’une hypoglyc�mie s�v�re.
-
Veiller � emp�cher le b�b� de se refroidir. L’envelopper
dans un linge doux et sec, puis dans une couverture et veiller � ce
que sa t�te soit couverte pour �viter la d�perdition de chaleur.
-
Le transf�rer au plus vite dans le service
appropri� pour les nouveau-n�s malades.
ENFANT MODEREMENT PREMATURE OU DE FAIBLE POIDS A LA
NAISSANCE
Les enfants mod�r�ment pr�matur�s (n�s entre 33 et
36 semaines) ou de faible poids � la naissance (entre 1 500 et 2 500 g)
sont susceptibles de d�velopper des probl�mes peu de temps apr�s la
naissance.
- le laisser avec sa m�re ;
- dans la mesure du possible, inciter la m�re �
commencer l’allaitement dans l’heure qui suit la naissance.
RUPTURE PREMATUREE ET/OU PROLONGEE DES MEMBRANES ET
NOUVEAU-NE ASYMPTOMATIQUE
Les principes suivants ont une valeur indicative et
peuvent �tre modifi�s en fonction du contexte local.
- laisser l’enfant avec sa m�re et encourager cette
derni�re � poursuivre l’allaitement ;
- prendre les dispositions n�cessaires pour que le
service s’occupant des nouveau-n�s malades fasse une h�moculture
et commence � administrer une antibioth�rapie � l’enfant.
- le laisser avec sa m�re et inciter cette derni�re
� poursuivre l’allaitement ;
- si des signes d’infection apparaissent dans les 3
premiers jours, prendre
les dispositions n�cessaires pour que le service appropri� pour les
nouveau-n�s malades fasse une h�moculture et commence � administrer
une antibioth�rapie � l’enfant.
SYPHILIS CONGENITALE
- un œd�me g�n�ralis�
- une �ruption cutan�e ;
- des v�sicules cutan�es sur la paume des mains et
la plante des pieds ;
- une rhinite ;
- un condylome anal ;
- un foie volumineux ou une rate volumineuse ;
- la paralysie d’un membre ;
- l’ict�re ;
- la p�leur ;
- la d�tection de spiroch�tes � l’examen sur fond
noir de la l�sion, de liquide organique ou de liquide
c�phalo-rachidien.
-
Si le test s�rologique de la m�re est positif
ou si elle pr�sente les sympt�mes de la syphilis mais que l’enfant
ne pr�sente pas de signe de syphilis, que la m�re ait �t�
trait�e ou non, injecter au nouveau-n� une dose unique de 50 000
unit�s de benzathine p�nicilline par kg, en IM.
Top of page

