TRAVAIL EUTOCIQUE
-
Evaluer rapidement l’�tat g�n�ral de la patiente, en
particulier les signes vitaux (pouls, tension art�rielle,
respiration, temp�rature).
-
Evaluer l’�tat du fœtus :
- Ecouter le rythme cardiaque fœtal imm�diatement apr�s une
contraction :
- compter les battements cardiaques fœtaux pendant une minute
enti�re, au moins toutes les 30 minutes pendant la phase active et
toutes les 5 minutes pendant la phase d’expulsion ;
- si le rythme cardiaque fœtal est anormal (inf�rieur �
100 btts/ min ou sup�rieur � 180 btts/min), penser � une
souffrance fœtale.
- Si les membranes sont rompues, prendre note de la
couleur du liquide amniotique qui s’�coule :
- la pr�sence d’un m�conium �pais indique qu’il faut
surveiller attentivement la patiente et qu’il peut �tre
n�cessaire d’intervenir pour traiter une souffrance fœtale.
- l’absence d’�coulement apr�s la rupture des membranes
indique un oligoamnios, qui risque d’�tre associ� � une
souffrance fœtale.
ACCOMPAGNEMENT PENDANT LE TRAVAIL ET L’ACCOUCHEMENT
- encourager l’accompagnant qu’elle a choisi pour son
accouchement � la soutenir ;
- faire le n�cessaire pour que l’accompagnant puisse s’asseoir
aupr�s d’elle ;
- encourager l’accompagnant � lui apporter un soutien adapt�
pendant le travail et l’accouchement (� lui masser le dos, lui
essuyer le front avec un gant humide, l’aider � se
d�placer).
- � ce qu’il lui explique tout ce qui va �tre fait, sollicite
son autorisation et lui fasse part des r�sultats ;
- � ce qu’il cr�e un climat dans lequel elle se sente
soutenue et encourag�e pour accoucher et o� elle ait le sentiment
qu’on respecte sa volont� ;
- � ce qu’il veille � son intimit� et � la confidentialit�
des actes et entretiens.
- l’encourager � se laver, � prendre un bain ou une douche au
d�but du travail;
- laver les r�gions de la vulve et du p�rin�e avant chaque
examen ;
- se laver les mains au savon avant et apr�s chaque examen
;
- veiller � la propret� du/des lieu(x) pr�vu(s) pour le
travail et l’accouchement ;
- nettoyer imm�diatement toute projection ou tout �coulement de
liquide.
- l’encourager � se d�placer librement ;
- approuver la position qu’elle a choisie pour accoucher (figure
P-2).
Note : Ne pas donner syst�matiquement un lavement aux
femmes en travail.
-
L’encourager � boire et manger � sa convenance. Si elle
est visiblement tr�s amaigrie ou se fatigue pendant le travail,
veiller � ce qu’elle soit nourrie. Les boissons nutritives sont
importantes, m�me � un stade avanc� du travail.
-
Lui enseigner les techniques respiratoires pour le travail et l’accouchement.
L’encourager � expirer plus lentement qu’� l’accoutum�e
et � se d�tendre � chaque expiration
-
Si la patiente est anxieuse ou effray�e ou si elle souffre
pendant le travail :
- la f�liciter, l’encourager et la rassurer ;
- lui expliquer le processus du travail et la tenir au courant du
d�roulement des �v�nements ;
- l’�couter et �tre attentif � ce qu’elle ressent.
- sugg�rer � la patiente de changer de position (figure
P-2) ;
- l’encourager � ne pas rester immobile ;
- encourager son accompagnant � lui masser le dos ou � lui
tenir la main et � lui �ponger le visage entre les contractions
;
- l’encourager � mettre les techniques respiratoires en
application ;
- l’encourager � prendre un bain ou une douche chauds ;
- si n�cessaire, lui injecter lentement 1 mg de p�thidine par
kg (mais pas plus de 100 mg) en IM ou en IV, ou 0,1 mg de morphine
par kg en IM.
Figure P-2
Positions qu'une femme est susceptible d'adopter pendant le travail
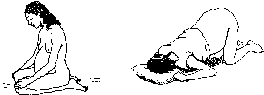
DIAGNOSTIC
Le diagnostic du travail comprend :
-
diagnostic et confirmation du travail ;
-
diagnostic du stade et de la phase du travail ;
-
�valuation de l’engagement et de la descente du fœtus
;
-
d�termination de la pr�sentation et de la position
du fœtus.
Un diagnostic erron�
du travail peut �tre une source d’anxi�t� et d’interventions
inutiles.
DIAGNOSTIC ET CONFIRMATION DU TRAVAIL
- des douleurs abdominales intermittentes apr�s 22
semaines de grossesse;
- des douleurs g�n�ralement associ�es � des pertes
vaginales gluantes et filantes, teint�es de sang (expulsion du
bouchon muqueux) ;
- des pertes vaginales aqueuses ou un �coulement d’eau
soudain.
- effacement du col : raccourcissement et
amincissement progressifs du col; et
- dilatation du col : �largissement du diam�tre
de l’orifice, en cm (figure P-3, A-E, ci-dessous).
Figure P-3
Effacement et dilatation du col

Tableau P-8
Diagnostic du stade et de la phase du travaila
|
Sympt�m�s
et signes cliniques |
Stade |
Phase
|
|
• Col non
dilat�
|
faux
travail/travail non entam�
|
|
|
• dilatation du
col inf�rieure � 4 cm
|
premier stade
|
phase de latence
|
|
• dilatation du
col comprise entre 4 et 9 cm
• rythme de
dilatation g�n�ralement de 1cm/h au moins
• d�but de la
descente foetale
|
premier stade
|
phase active
|
|
• col
compl�tement dilat� (10 cm)
• poursuite de
la descente foetale
• pas de forte
envie de pousser
|
deuxi�me stade
|
phase initiale
(de non-d'expulstion)
|
|
• col
compl�tement dilat� (10 cm)
• la
pr�sentation foetale atteint le plancher pelvien
• forte envie de
pousser
|
deuxi�me stade
|
phase finale
(d'expulsion)
|
aLe troisi�me stade du travail d�bute avec l’accouchement
et se termine avec l’expulsion du placenta.
|
DESCENTE
PALPER ABDOMINAL
-
Par un palper abdominal, mesurer la descente de la
t�te en cinqui�mes de t�te palpables au-dessus de la symphyse
pubienne (fig. P-4, A-D, ci-dessous).
- Lorsque la t�te se trouve enti�rement
au-dessus de la symphyse pubienne, les 5 cinqui�mes (5/5) sont
palpables (fig. P-4, A-B, ci-dessous).
- Lorsque la t�te se trouve enti�rement au-dessous
de la symphyse pubienne, elle n’est pas du tout (0/5)
palpable.
Figure P-4
Palper abdominal �valuant la descente de la
t�te fœtale

TOUCHER VAGINAL
-
Si n�cessaire, proc�der � un toucher vaginal pour
estimer la descente du mobile fœtal en appr�ciant la hauteur de la
pr�sentation par rapport aux �pines sciatiques du bassin maternel
(figure P-5, ci-dessous).
Note : Lorsqu’il y a une grosse bosse
s�ro-sanguine ou un degr� important de modelage de la t�te, il
est plus utile d’estimer la descente de la t�te fœtale par un
palper abdominal en utilisant la m�thode des cinqui�mes de t�te
palpables que par un toucher vaginal.
Figure P- 5
Estimation de la descente de la t�te fœtale par un toucher
vaginal ; le niveau 0 se trouve au niveau des �pines sciatiques

PRESENTATION ET POSITION
DETERMINER LA PRESENTATION
-
La pr�sentation la plus courante est le sommet de
la t�te fœtale. Consid�rer toute pr�sentation autre que le
sommet comme dystocique (tableau
S-12).
-
Pour la pr�sentation du sommet, utiliser les
points de rep�re du cr�ne fœtal pour d�terminer la position de
la t�te fœtale dans le bassin maternel (figure P-6).
Figure P- 6
Rep�res du cr�ne fœtal

DETERMINER LA POSITION DE LA TETE FŒTALE
Figure P- 7
Positions occipito-iliaques transverses


Figure P- 8
Positions occipitales ant�rieures
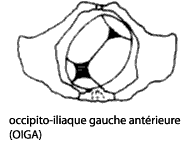


La pr�sentation normale a une caract�ristique
suppl�mentaire : c’est un sommet bien fl�chi (figure P-9),
position dans laquelle l’occiput fœtal se situe plus bas dans le
vagin que le sinciput (bregma).
Figure P- 9
Sommet bien fl�chi
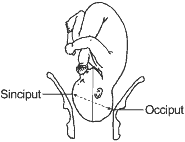
ESTIMATION DU DEROULEMENT DU TRAVAIL
Une fois qu’on a diagnostiqu� le travail, on peut
�valuer son d�roulement :
-
en mesurant l’effacement et la dilatation
progressifs du col (figure P-3 A-E) pendant la phase de
latence ;
-
en mesurant le rythme de la dilatation du col et de
la descente du mobile fœtal (figure P-4 et figure
P-5) pendant la phase active ; �
-
en estimant la suite de la descente pendant le
deuxi�me stade.
Il convient de reporter le d�roulement du premier
stade du travail sur un partogramme une fois que la parturiente entre
dans la phase active du travail. La figure P-10
repr�sente un
partogramme type. A d�faut de partogramme, on peut tracer une courbe
simple en mettant la dilatation du col (en cm) en ordonn�e et le temps
(en h) en abscisse.
TOUCHERS VAGINAUX
Il convient de faire un toucher vaginal au moins toutes les 4
heures au premier stade du travail et apr�s la rupture des membranes.
Reporter les r�sultats sur un partogramme.
- couleur du liquide amniotique ;
- dilatation du col ;
- descente (�galement mesurable au moyen d’un palper
abdominal).
- Si les contractions persistent, r�examiner
la patiente 4 h plus tard et rechercher des modifications au niveau du
col. A ce moment l�, s’il y a eu effacement et dilatation du col,
la patiente est en travail ; s’il n’y a pas de modification,
diagnostiquer un faux travail.
UTILISATION DU PARTOGRAMME
Le partogramme de l’OMS a �t� modifi� afin d’en
simplifier l’utilisation. D�sormais, la phase de latence n’y figure
plus et le trac� ne commence qu’avec la phase active, une fois que le
col a atteint une dilatation de 4 cm. Ce manuel comporte un partogramme
type (figure P-10). Noter qu’il convient de le ramener � l’�chelle
r�elle avant de l’utiliser. Les informations � consigner sur le
partogramme sont les suivantes.
Renseignements concernant la patiente : remplir
les rubriques nom, gestit�, parit�, num�ro de dossier, date et heure
d’admission, heure de rupture des membranes.
Rythme cardiaque fœtal : toutes les
demi-heures.
Liquide amniotique : couleur du liquide
amniotique � chaque toucher vaginal, inscrire en outre :
-
un I si les membranes sont intactes ;
-
un R si les membranes sont rompues ;
-
un C si les membranes sont rompues et que le liquide
amniotique est clair ;
-
un M si le liquide amniotique est teint� de
m�conium ;
-
un S si le liquide amniotique est teint� de
sang.
Modelage de la t�te : noter :
-
1 : si les os du cr�ne sont appos�s ;
-
2 : s’ils se chevauchent mais que le chevauchement
est r�ductible ;
-
3 : s’ils se chevauchent et que le chevauchement est
irr�ductible.
Dilatation du col : �valuer � chaque
toucher vaginal et marquer d’une croix (X), commencer le trac� de la
courbe � 4 cm.
Ligne d’alerte : segment prenant son
origine � 4 cm de dilatation et se terminant au point o� la dilatation
doit �tre compl�te, � raison d’une progression de 1 cm par
heure.
Ligne d’action : parall�le � la ligne d’alerte,
4 h plus � droite.
Descente �valu�e � la palpation de l’abdomen
: concerne la partie de la t�te (divis�e en 5) palpable au-dessus
de la symphyse pubienne ; la marquer d’un cercle (O) � chaque
toucher vaginal ; � 0/5, le sinciput (B) est au niveau de la symphyse
pubienne.
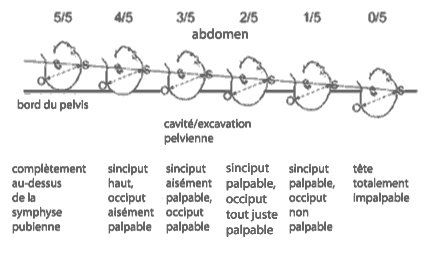
Nombre d’heures : concerne le temps
�coul� depuis le d�but de la phase active du travail (observ� ou
d�duit).
Heure : l’heure qu’il est.
Nombre de contractions : toutes les
demi-heures ; d�terminer � la palpation le nombre de contractions en
10 minutes et noter leur dur�e (en secondes) :
-
 si
elles durent moins de 20 secondes ;
si
elles durent moins de 20 secondes ;
-
 si
elles durent entre 20 et 40 secondes ;
si
elles durent entre 20 et 40 secondes ;
-
 si
elles durent plus de 40 secondes.
si
elles durent plus de 40 secondes.
Ocytocine : en cas d’utilisation, noter
toutes les 30 minutes la quantit� d’ocytocine administr�e par volume
de liquide perfus�, en gouttes par minute.
M�dicaments
: noter tout apport m�dicamenteux.
Pouls : toutes les 30 minutes et marquer d’un
point (●).
Tension art�rielle : mesurer toutes les 4 h
et indiquer avec des fl�ches.
Temp�rature : toutes les 2 h.
Urine : quantit� de prot�ines, d’ac�tone et
volume : noter � chaque miction.
Figure P-10 > Partogramme modifi� de l'OMS
La figure P-11 repr�sente le partogramme d’un
travail eutocique.
- la t�te fœtale �tait palpable � 4/5 ;
- la dilatation du col �tait de 2 cm ;
- la patiente avait 3 contractions en 10 min et chaque
contraction durait 20 s ;
- l’�tat de la future m�re et du fœtus �tait
normal.
Note : Ces informations ne figurent pas sur le
partogramme.
- la t�te fœtale �tait palpable � 3/5 ;
- la dilatation du col �tait de 5 cm ;
Note : La patiente �tait entr�e dans la phase
active du travail et ces informations figurent sur le partogramme. La
dilatation du col est inscrite sur la ligne d’alerte.
- la patiente avait 4 contractions en 10 min et chaque
contraction durait 40 s ;
- la dilatation du col progressait � un rythme de 1
cm par heure.
- la t�te fœtale n’�tait plus palpable ;
- le col �tait compl�tement dilat� ;
- la patiente avait 5 contractions en 10 min et chaque
contraction durait 40 s ;
- l’accouchement spontan� par voie basse a eu lieu
� 14 h20.
Figure P- 11 > Exemple
de partogramme d'un accouchement eutocique
D�ROULEMENT DU PREMIER STADE DU TRAVAIL
- contractions r�guli�res de fr�quence et de dur�e
croissantes ;
- progression de la dilatation de 1 cm par heure
pendant la phase active du travail (dilatation sur la ligne d’alerte
ou � gauche de celle-ci) ;
- col bien appliqu� sur la pr�sentation.
- contractions irr�guli�res et peu fr�quentes
apr�s la phase de latence ; OU
- progression de la dilatation cervicale inf�rieure
� 1 cm par heure pendant la phase active du travail (dilatation �
droite de la ligne d’alerte) ; OU
- col mal appliqu� sur la pr�sentation.
Un
d�roulement d�favorable du travail peut se traduire par un travail
prolong� (tableau
S-10).
D�ROULEMENT DU DEUXIEME STADE DU TRAVAIL
- descente constante du fœtus dans la fili�re
g�nitale ;
- d�but de la phase d’expulsion (efforts de
pouss�e).
- absence de descente du fœtus dans la fili�re
g�nitale ;
- �chec de l’expulsion � la fin de la phase finale
(d’expulsion).
SURVEILLANCE FŒTALE
-
Si le rythme cardiaque fœtal est anormal
(inf�rieur � 100 btts/min ou sup�rieur � 180 btts/min), penser
� une souffrance fœtale
-
Pendant le travail, les positions ou pr�sentations
autres que la pr�sentation d’un sommet bien fl�chi en position
occipito-iliaque ant�rieure sont consid�r�es comme des
pr�sentations et positions dystociques.
-
Si la progression du travail est apparemment
d�favorable ou si le travail est prolong�, traiter la
cause du retard.
SURVEILLANCE MATERNELLE
Examiner la patiente et rechercher des signes de
d�tresse :
-
Si son pouls s’acc�l�re, c’est
peut-�tre qu’elle est d�shydrat�e ou qu’elle souffre. Veiller
� bien l’hydrater par voie orale ou veineuse et � lui donner l’analg�sie
n�cessaire.
-
Si sa tension art�rielle baisse, penser �
une h�morragie.
-
Si elle a de l’ac�tone dans les urines,
envisager la possibilit� qu’elle soit en hypoglyc�mie et lui
injecter une solution intraveineuse de dextrose.
ACCOUCHEMENT EUTOCIQUE
L'accompagnement pendant le travail
est la meilleure fa�on d'aider la patiente � supporter les douleurs du
travail.
-
Une fois que le col est compl�tement dilat�
et que la phase d’expulsion du deuxi�me stade du travail est
entam�e, encourager la parturiente � prendre la position qui
lui convient le mieux (figure P-12, ci-dessous) et � commencer les
efforts expulsifs.
Figure P-12
Positions qu'une femme est susceptible d'adopter
pendant l'accouchement

Note : D�sormais, il n’est plus recommand� de
pratiquer syst�matiquement une �pisiotomie. Il n’a pas �t�
d�montr� que l’�pisiotomie syst�matique r�duisait les l�sions
p�rin�ales, ni le risque de colpoc�le ou d’incontinence urinaire.
En fait, l’�pisiotomie syst�matique est associ�e � un nombre de
d�chirures p�rin�ales compl�tes et compl�tes compliqu�es et � une
proportion de dysfonctionnements du sphincter anal, qui en r�sultent,
sup�rieurs � la moyenne.
DEGAGEMENT DE LA TETE
-
Demander � la patiente de �souffler� ou de ne
pousser que l�g�rement lors des contractions pendant le
d�gagement de la t�te.
-
Afin de ma�triser l’expulsion de la t�te,
prendre la t�te d’une main pour la maintenir en flexion
(inclin�e).
-
Continuer � soutenir d�licatement le p�rin�e
pendant le d�gagement de la t�te.
-
Une fois que la t�te est d�gag�e, demander � la
patiente d’arr�ter de pousser.
-
Aspirer les mucosit�s dans la bouche et le nez de l’enfant.
-
Passer la main autour de son cou pour chercher le
cordon ombilical :
- si le cordon est enroul� autour du cou mais
l�che, le faire glisser par-dessus la t�te du b�b� ;
- s’il est enroul� �troitement autour du cou de
l’enfant, le clamper en deux endroits et le couper avant de le
d�rouler.
TERMINAISON DE L’ACCOUCHEMENT
-
Laisser la rotation de la t�te se faire
spontan�ment.
-
Ensuite, poser une main de chaque c�t� de la t�te
de l’enfant et demander � la patiente de pousser calmement � la
contraction suivante.
-
R�duire le risque de d�chirure en ne d�gageant qu’une
�paule � la fois. Ramener la t�te de l’enfant vers l’arri�re
pour d�gager l’�paule ant�rieure.
Note : Si les �paules sont difficiles
� d�gager, envisager la possibilit� d’une dystocie des
�paules.
-
Soulever la t�te de l’enfant vers l’avant pour
d�gager l’�paule post�rieure.
-
Soutenir le reste du corps de l’enfant d’une
main pendant qu’il se d�gage.
-
Poser l’enfant sur le ventre de sa m�re. Le
s�cher soigneusement, lui essuyer les yeux et appr�cier sa
respiration.
Note : La plupart des b�b�s commencent �
crier ou � respirer spontan�ment dans les 30 secondes qui suivent la
naissance.
- Si le b�b� crie ou respire (sa poitrine se
soul�ve au moins 30 fois par minute), le laisser avec sa m�re.
- Si le b�b� ne commence pas � respirer dans les
30 secondes, APPELER A L’AIDE et prendre les mesures qui
s’imposent pour le ranimer .
Anticiper le besoin
de r�animation et s’organiser pour pouvoir obtenir de l’aide pour
toutes les naissances, et plus particuli�rement en cas d’�clampsie,
d’h�morragie, de travail prolong�, d’accouchement pr�matur� ou
de contexte infectieux.
-
Clamper le cordon ombilical et le sectionner.
-
Veiller � ce que le b�b� soit au chaud. L’installer
sur la poitrine de sa m�re, peau contre peau. L’envelopper dans
un linge doux et sec puis dans une couverture et veiller � ce que
sa t�te soit bien couverte pour �viter qu’il ne se
refroidisse.
-
Si la m�re ne se sent pas bien, demander �
un/une aide de s’occuper de l’enfant.
-
Palper l’abdomen pour �carter l’�ventualit�
de la pr�sence d’un deuxi�me enfant et poursuivre en prenant
activement en charge le troisi�me stade du travail.
PRISE EN CHARGE ACTIVE DU TROISIEME STADE DU TRAVAIL
Le fait de prendre activement en charge le troisi�me
stade du travail (d�livrance assist�e) aide � pr�venir une
h�morragie du post-partum. La prise en charge active du troisi�me
stade du travail consiste � :
OCYTOCINE
-
Dans la minute qui suit l’accouchement, palper l’abdomen
de la m�re pour �carter l’�ventualit� d’un autre/d’autres
b�b�(s) et administrer 10 unit�s d’ocytocine en IM.
-
On recommande d’utiliser de l’ocytocine parce qu’elle
fait effet 2 � 3 minutes apr�s l’injection, que ses effets
secondaires sont minimes et qu’on peut en donner � toutes les
femmes. Si l’�tablissement n’a pas d’ocytocine,
injecter 0,2 mg d’ergom�trine en IM ou utiliser des
prostaglandines. S’assurer qu’il n’y a pas d’autre fœtus
avant d’injecter ces m�dicaments.
Ne pas donner d’ergom�trine
aux femmes atteintes de pr��clampsie, d’�clampsie ou d’hypertension
art�rielle car cela accro�t le risque de convulsions et d’accidents
vasculaires c�r�braux.
TRACTION MESUREE SUR LE CORDON OMBILICAL
-
Clamper le cordon � proximit� du p�rin�e en
utilisant une pince porte-tampons. Maintenir le cordon et la pince
dans une main.
-
Placer l’autre main juste au-dessus du pubis de la
patiente et stabiliser l’ut�rus en exer�ant une l�g�re
pression vers le haut pendant que de la main qui tient la pince on
exerce une traction mesur�e sur le cordon. La contre-traction ainsi
exerc�e refoule le fond ut�rin et contribue � �viter une
inversion de l’ut�rus.
-
Maintenir une l�g�re tension sur le cordon et
attendre une forte contraction de l’ut�rus (2 � 3 min).
-
Lorsque l’ut�rus s’arrondit ou que le cordon
s’allonge, tirer tr�s doucement sur le cordon, en direction
du bas, pour extraire le placenta. Ne pas attendre que du sang gicle
pour exercer une traction sur le cordon. De l’autre main,
maintenir la pression vers le haut.
-
Si le placenta ne descend pas dans les 30 �
40 secondes qui suivent la traction mesur�e sur le cordon (c’est-�-dire,
s’il n’y a pas de signe de d�collement du placenta), cesser de
tirer sur le cordon.
- Tenir d�licatement le cordon et attendre que l’ut�rus
soit � nouveau bien contract�. Si n�cessaire, d�placer la pince
pour clamper le cordon plus pr�s du p�rin�e � mesure qu’il s’allonge.
- A la contraction suivante, renouveler la traction
mesur�e sur le cordon en maintenant la pression vers le haut par la
main sus-pubienne.
Ne jamais exercer
de traction sur le cordon (tirer) sans exercer simultan�ment, avec l’autre
main, une contre-traction (pousser vers le haut) au-dessus de l’os
pubien.
-
Pendant l’expulsion du placenta, les membranes
peuvent se d�chirer. Prendre le placenta avec les deux mains et le
faire tourner d�licatement jusqu’� ce que les membranes soient
enroul�es sur elles-m�mes.
-
Tirer lentement pour parachever la d�livrance.
-
Si les membranes se d�chirent, examiner avec
d�licatesse la partie sup�rieure du vagin et du col avec des gants
d�sinfect�s et utiliser une pince porte-tampons pour retirer tous
les d�bris de membranes.
-
Examiner soigneusement le placenta pour �tre s�r
qu’il est complet. S’il manque une partie de la surface
maternelle ou si les membranes qui contiennent des vaisseaux sont
d�chir�es, envisager la possibilit� d’une r�tention
placentaire partielle.
-
En cas d’inversion ut�rine, repositionner
l’ut�rus.
-
Si le cordon est arrach�, il peut �tre
n�cessaire de proc�der � une d�livrance artificielle.
-
MASSAGE UTERIN
-
Masser imm�diatement le fond ut�rin � travers la
paroi abdominale jusqu’� ce que l’ut�rus se contracte.
-
Renouveler le massage ut�rin toutes les 15 minutes
pendant les 2 premi�res heures.
-
S’assurer que l’ut�rus ne se rel�che pas
(ut�rus mou) quand on interrompt le massage ut�rin.
-
EXAMEN DES LESIONS
PREMIERS SOINS NEONATALS
- s’il a les pieds froids, v�rifier sa
temp�rature axillaire ;
- si sa temp�rature est inf�rieure � 36,5�C,
le r�chauffer.
-
Examiner le cordon toutes les 15 minutes pour voir s’il
saigne. Si le cordon saigne, faire un nœud plus serr�.
-
Appliquer un antimicrobien en gouttes (solution de
nitrate d’argent � 1% ou solution de polyvidone iod�e � 2,5%)
ou en pommade (pommade de t�tracycline � 1%) sur les yeux du
b�b�.
Note : Ne pas confondre la polyvidone iod�e
avec la teinture d’iode qui pourrait rendre le b�b� aveugle.
-
Essuyer la peau de l’enfant pour en retirer le
m�conium et le sang.
-
Inciter la m�re � commencer � allaiter le b�b�
d�s qu’il a l’air pr�t (d�s qu’il commence � manifester un
r�flexe de fouissement). Ne pas le forcer � prendre le sein.
Eviter autant que
possible de s�parer la m�re de l’enfant. Ne laisser � aucun moment
la m�re et l’enfant sans surveillance.
Top of page

